

 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
 |
||

La Planète des Singes






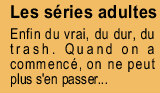

|
Partis réaliser le grand rêve des sixties, la conquête de l'espace, des astronautes américains finissent par se crasher au beau milieu du lac Powell, dans une séquence digne d'Ed Wood - le caméraman devant être un derviche tourneur reconverti. Le temps pour Charlton Heston d'une épitaphe virile pour l'alibi féminin de l'équipe ("elle aurait fait une belle Eve"), et voilà nos mâles survivants partis pour une (longue...) séance de trekking dans la vallée de la mort, prétexte à quelques démonstrations de testostérones et autres réflexions sur notre putain de société décadente ("j'avais des femmes la-bas, beaucoup de femmes, pour faire l'amour, mais pas d'amour alors je suis parti"). Après ce cauchemardesque -pour eux comme pour nous- premier acte, nos sympathiques héros rencontrent successivement les indigènes, puis les premiers singes. Paradoxe, ici ce sont les singes qui chassent les humains, permettant au passage de se débarrasser de l'alibi afro-américain de l'équipe et de laisser le champ libre à Charlton, traîtreusement capturé par ces fourbes de gorilles.
Charlton Heston, alors au faîte de sa gloire virile, en fait des tonnes, sourire hâbleur et torse velu en avant, vampirise complètement son personnage et finit par arriver à cet exploit troublant, cette mise en abyme du star-system hollywoodien : il arrive à surjouer dans son propre rôle. Au diapason de sa vedette, Franklin Schaffner, spécialiste du film de guerre (Patton, The War Lord) n'hésite pas à en rajouter dans le démonstratif, des fois que ceux du fond ne soient pas très attentifs et n'aient pas très bien compris qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Jerry Goldsmith, compositeur multirécompensé avec plus de 200 films au compteur, participe à la fête avec une partition pompière dans la grande tradition de la série Z qui parvient à alourdir encore un peu plus l'ensemble Quant aux pauvres scénaristes ils souffrent aussi. Ils essayent de caser dans une trame linéaire la lutte pour les droits civiques, un hymne à la gloire de Charlton Heston, la guerre froide, des effets spéciaux qui tuent, une réflexion sur les dangers de la science, ceux de la religion, une jolie brune préhistorique en string de fourrure, une étude de caractère plutôt velue, des scènes d'actions et un questionnement sur l'Humain (ouf !), le tout en restant accessible au premier amateur de pop-corn venu. Inutile de dire que c'est plutôt raté. Entre mystères insondables (mais pourquoi ces singes parlent-ils anglais ?) et passages inutiles (mais pourquoi passer dix minutes sur une évasion ratée ?), on navigue à vue en attendant le dernier quart d'heure, qui certes dénoue tout mais sans que cette énième péripétie foireuse n'arrive vraiment à convaincre. Au vu de cet indigeste gloubi-boulga, on se demande bien ce qui a permis à ce film de devenir une oeuvre culte avec cinq (inénarrables...) suites, une série TV, et ses cohortes d'aficionados intransigeants.
Flop |

 On
a la sensation que le film commence, enfin, et se fait plus acide, avec des
pointes d'ironie cruelle comme cette scène ou les chasseurs/gorilles
posent fièrement devant le tas d'humains/proies abattus. Mais l'ensemble
reste bien inégal, constamment tiraillé entre un sujet redoutablement
subversif et une volonté de faire rentrer au maximum les sous dans la
caisse.
On
a la sensation que le film commence, enfin, et se fait plus acide, avec des
pointes d'ironie cruelle comme cette scène ou les chasseurs/gorilles
posent fièrement devant le tas d'humains/proies abattus. Mais l'ensemble
reste bien inégal, constamment tiraillé entre un sujet redoutablement
subversif et une volonté de faire rentrer au maximum les sous dans la
caisse. Sans
doute cette intuition géniale de Boulle, cette science-fiction si proche
de nous qui, par le renversement des rôles qu'elle opère, nous
renvoie mécaniquement à notre angoisse sur notre condition d'humains.
Peu importe finalement le récit, la simple idée de ce monde de
singes nous rappelle notre fascination/répulsion pour notre part de bestialité,
nous interroge sur notre panique à l'idée d'être la seule
espèce intelligente de l'univers.
Sans
doute cette intuition géniale de Boulle, cette science-fiction si proche
de nous qui, par le renversement des rôles qu'elle opère, nous
renvoie mécaniquement à notre angoisse sur notre condition d'humains.
Peu importe finalement le récit, la simple idée de ce monde de
singes nous rappelle notre fascination/répulsion pour notre part de bestialité,
nous interroge sur notre panique à l'idée d'être la seule
espèce intelligente de l'univers. Et
puis, il y a cette scène finale, qui suffirait presque à sauver
le film, et puis, il y a le torse viril de Charlton...
Et
puis, il y a cette scène finale, qui suffirait presque à sauver
le film, et puis, il y a le torse viril de Charlton...